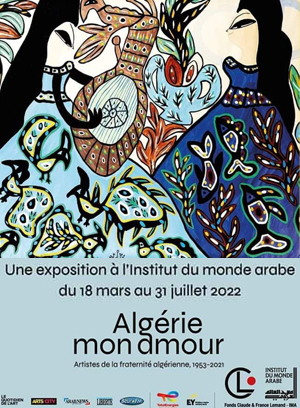A l’origine de Good luck Algeria, il y a une histoire vraie : celle de votre frère.
Mon producteur Frédéric Jouve et moi avions envie de raconter une histoire positive sur l’immigration. Frédéric a grandi à Marseille, avec beaucoup d’amis d’origine algérienne et à force de discuter sur comment aborder l’histoire de ceux qui sont entre deux pays, on a eu l’évidence qu’il fallait s’inspirer de l ’aventure de mon frère, qui a fait les Jeux Olympiques d’hiver sous la bannière de l’Algérie à Turin en 2006. Son aventure symbolisait vraiment la trajectoire qu’on voulait raconter : un franco-algérien qui habite en France et se lance dans un défi qui va le rapprocher de ses racines.
L’argument initial de Good luck Algeria relève de la comédie sociale puis le film s’ouvre sur une problématique plus ample sur l’héritage familial et culturel.
L’humour était essentiel au début car l’on éprouve de l’empathie pour Samir et l’on a envie de le suivre jusqu’au bout. Et puis le fait qu’il fasse les JO en ski pour l’Algérie a un potentiel comique très fort qu’il fallait traiter. C’est aussi pour ça que j’ai pris Franck Gastambide pour jouer son acolyte. Il est d’emblée sympathique et il a un rapport très beau et simple à la comédie.
Je pars de l’anecdote de mon frère mais le film développe ensuite une problématique plus vaste autour de la famille. En 2007, j’ai fait un documentaire sur ma famille et j’en ai gardé pas mal de frustrations sur la manière de traduire la situation complexe de vivre entre deux pays comme le font mes parents. J’ai donc eu envie d’y revenir par le biais de la fiction, qui est vraiment mon métier. Il y a plein de films en un dans Good luck Algeria: un film sur l’entreprise, un film sur la famille et les racines, un film de sport… Et c’est un peu une comédie, un peu un drame…
La scène où le père prépare les drapeaux algériens pour soutenir son fils dans son combat olympique est à la fois drôle et touchante.
Cette scène est du vécu : quand mon frère a décidé de faire les Jeux Olympiques, mon père a fabriqué des drapeaux, fait un gâteau énorme aux couleurs de l’Algérie. Et il a loué un bus pour qu’on le suive à Turin ! C’était vraiment une aventure familiale énorme. Voir le drapeau algérien au milieu des autres drapeaux à Turin… Mais on n’a jamais vraiment discuté, ni avec mon père, ni avec mon frère, de sa dimension patriotique, on est toujours restés très concrets et le film l’est aussi. Le père n’a pas de réflexion sur la patrie et le symbole du drapeau. Il est juste très fier de son fils.
Son père dit quelque chose de très beau à Samir : il ne s’est pas battu pour l’intégration mais pour que ses enfants aient le choix.
Oui, et quand le choix de son fils est de monter sa boîte et non de planter des oliviers en Algérie, il ne peut que le soutenir jusqu’au bout et l’aider. Ce père a un côté très parfait ! Pour lui, l’important est l’ascension sociale, pas l’intégration proprement dite dans une culture française. Good luck Algeria est aussi une réponse à tous les Algériens ou descendants d’Algériens qui se demandent s’ils doivent renier leur culture algérienne pour s’intégrer. L’identité nationale n’est pas une question de patrie, ni de manger du porc, c’est une question d’humain, de ce que l’on fait de sa vie. Moi, j’ai grandi en France, j’y ai construit mes projets, je suis français. Le fait que Samir doive faire les JO sous la bannière algérienne pour sauver sa boîte qui fait des skis cent pour cent français est un pied de nez à tous les débats sur l’identité nationale !
Tous les personnages ont cette caractéristique d’être des personnes sinon parfaites comme le père, du moins bienveillantes.
Effectivement, il n’y a aucun méchant dans le film, aucun conflit extérieur. Le conflit est intérieur, dans cette double origine qui constitue Samir. Il se sent bien au début, il fait des skis cent pour cent français, il est en France… Et puis il se rend compte qu’il y a un conflit à résoudre à l’intérieur de lui.
Même la banquière n’est pas antipathique.
Non, c’est juste qu’elle fait se confronter le projet poétique de Samir à la réalité. Ca ne servait à rien que cette banquière soit dure. C’est même plus fort de voir Samir s’opposer à quelqu’un qui le trouve sympathique. Du coup, même si on est de son côté à lui, on entend ses doutes à elle. D’autant plus que son copain Stéphane lui-même n’y croit plus à un moment. Malgré toutes ces alertes, j’avais envie que le spectateur ait envie de suivre Samir jusqu’au bout. Au final, Samir a eu raison de croire en l’impossible, la poésie sort gagnante.
Le passage de la France à l’Algérie est comme un second souffle dans le film.
La première heure du film se passe sur trois mois environ alors que cette demi-heure en Algérie raconte une journée et demie. J’avais vraiment envie que ce personnage acharné à faire du sport, à courir pour sauver sa boîte, dans un rythme d’action à l’occidental expérimente soudain cette dilatation du temps propre au pays. Les Algériens se lèvent avec les poules et se couchent le soir tard, ils prennent le temps de discuter. On peut ne pas s’être vus pendant vingt ans mais on reste cousins. Je voulais qu’on ressente ce lien familial, que Samir lui-même l’éprouve, qu’il soit marqué par ce voyage. Lorsque le cousin de Samir lui montre les photos de ses enfants et lui dit que sa fille s’appelle Jihad et son fils Oussama, tout est dit sur la différence de vie et de culture entre eux mais le lien du sang reste très fort.
La dispute avec les oncles au sujet des terrains n’en reste pas moins très violente.
C’est aussi pour ça qu’il était important d’écrire un personnage avec lequel le public est totalement en empathie : quand on se retrouve dans la scène où Samir s’engueule avec ses oncles, on a envie qu’il ait ces vingt mille euros pour sauver son entreprise. On épouse son mode de pensée totalement occidental : c’est normal que son père garde ces terrains, ce sont les siens.
Certes, mais on comprend tout autant l’argument de ses oncles…
Oui, son mode de pensée se retrouve confronté à un autre mode de pensée tout aussi légitime : celui des oncles et cousins qui habitent au bled et qui vivent grâce à la culture de ces terrains-là. Personne n’a raison, chacun a ses raisons.
Cette confrontation avec les oncles est d’autant plus terrible pour le père de Samir que son fils ne parle pas arabe et que c’est lui qui est obligé de traduire une réalité qu’il n’a pas envie de comprendre : Samir ne reviendra pas au pays s’occuper de ses terrains, il est complètement dans sa vie en France. Ce retour aux racines ne tombe pas dans le sentimentalisme.
La scène où son père apprend à Samir qu’il a décidé de vendre les terrains est néanmoins très émouvante.
L’émotion surgit parce que les enjeux sont vitaux. Pour le père, ces arbres représentent une somme de travail accomplie tout au long d’une vie. Leur transmission n’est pas simplement une vague question d’héritage culturel, une idée administrative comme en Occident. Son rapport à la terre est trop concret : des arbres qu’il a plantés et arrosés, qui ont poussé et donnent des fruits.
C’est peut-être parce qu’il a cette notion très concrète de l’héritage que, paradoxalement, le père est capable de s’en séparer pour aider son fils.
Le père est celui qui fait le plus gros parcours dans le film : il décide de vendre ses terrains, de se faire enterrer en France… Il choisit là où sont ses enfants et sa femme, pas là où sont ses arbres et sa terre. Il privilégie l’humain à la notion de patrie, d’héritage, de biens matériels. Samir aussi au final, qui fait les JO pour sauver son entreprise mais aussi et peut-être avant tout pour faire plaisir à son père, pour que celui-ci soit fier de lui.
Pourquoi n’avez-vous pas tourné en Algérie ?
Trois semaines avant qu’on demande les autorisations, un Français s’est fait égorger dans les Aurès. Les assurances n’auraient pas voulu que l’on tourne en Algérie et nous-mêmes n’étions pas prêts à amener une équipe là-bas, c’était trop dangereux, hormis à Alger. Nous avons donc tourné les scènes dans Alger sur place, mais les autres scènes ont été tournées au Maroc, chez les Berbères. Du coup, les enfants ne parlaient pas arabe, on n’avait pas l’ambiance algérienne des femmes qui chantent dans les champs ou blaguent dans la cuisine, des hommes qui discutent au milieu des oliviers pendant la récolte… Heureusement, on a rajouté ensuite des ambiances sonores, des discussions en arabe algérien, que j’ai enregistrées dans ma famille en Algérie ou extraites de mon documentaire.
Pourquoi le choix de Sami Bouajila pour jouer Samir ?
Sami Bouajila a une palette de jeu très large, de l’humour à l’émotion la plus forte. Il se bat en permanence pour son rôle, il est à deux cent pour cent, du matin au soir. Son énergie est incroyable. J’ai vraiment écrit pour lui. Sa ressemblance avec mon frère est frappante, ils ont le même âge, sont tous les deux grenoblois… Quand il accepté le film, j’étais vraiment heureux, je ne sais pas comment j’aurais fait autrement.
Comment s’est-il préparé à ce rôle sportif ?
Il m’avait demandé une doublure pour les scènes de ski. J’ai donc fait appel à mon frère mais Sami était tellement engagé… Entre deux prises, il partait sur la piste et il skiait. Et puis il regardait mon frère. En deux jours, il avait tout compris de lui, de la position de ses bras sur les skis et très vite, il a voulu tout faire lui-même ! Mon frère l’a donc doublé les premiers jours seulement. Ou pour les plans larges quand je voulais que sa démarche soit plus professionnelle, plus élégante.
Sami a aussi rencontré mes parents, mes neveux… Quand il leur parlait, je voyais très bien qu’il était en observation permanente, prêt à s’inspirer du moindre geste. Même avec moi, il était comme une éponge – il est d’ailleurs allé voir la costumière pour être habillé comme moi dans le film ! Sami a littéralement plongé dans ma famille.
Comment avez-vous trouvé Bouchakor Chakor Djaltia, qui interprète le père de Samir ?
Je cherchais quelqu’un comme mon père, qui a grandi à la montagne, qui fait du ski et des raquettes, qui marche dans la neige… Tout cela forge une façon de parler, de s’habiller et d’être. Cela donne un corps totalement différent de celui de quelqu’un qui a travaillé dans une usine de la banlieue parisienne. Du coup, Antoine est descendu à Grenoble et a trouvé Bouchakor dans une association de vieux Algériens. Cet homme a eu une vie étonnante. Il a tenu un cabaret à Marseille dans les années 50, est reparti en Algérie en 1964, où il a vendu des coquillages sur la plage, a joué Shakespeare à Oran – quand je l’ai rencontré, il m’a cité Shakespeare en arabe ! Et puis il est revenu en France dans les années 90. Et là, il vit entre la France et l’Algérie. A quatre-vingt deux ans, il a encore une énergie incroyable et un regard plein d’enfance. Pour lui, ce tournage a été miraculeux, une expérience folle qui lui a permis d’aller en Autriche, au Maroc, en Italie…
Et le choix de Chiara Mastroiani et Hélène Vincent?
Chiara a un naturel et une force de caractère que j’avais beaucoup appréciés dans Un conte de Noël de Desplechin. C’est cette Chiara là dont j’avais envie et que je suis allé chercher. Une Chiara terrienne, qui a de l’humour et qui renvoie Samir à ses contradictions. Je l’ai dirigée pour qu’elle soit plus forte que lui tout le temps mais sans l’écraser et le juger. Elle a cette subtilité et cet humour, elle n’est pas la femme un peu mégère qui engueule son mari, le quitte ou l’envoie dormir sur le canapé. Je voulais qu’elle lui reproche de faire n’importe quoi mais l’aime aussi pour cette folie.
Quant à Hélène Vincent, c’est une comédienne magnifique, aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Deux ou trois prises suffisent, elle est magique, d’une précision dans le jeu. Et elle a les yeux bleus comme ma mère, ce qui ne gâche rien !
Comment avez-vous appréhendé la mise en scène ?
En partant vraiment des comédiens. Je suis moi-même comédien, je crois en leur instinct. Chaque matin, on voyait comment ils répétaient, là où ils étaient à l’aise, comment ils se parlaient et à partir de cette dynamique-là, on décidait le découpage. Avec à la base, l’idée de suivre Samir en permanence, de coller à sa vie, à ses doutes. Il est de tous les plans, ou presque.
Les seules scènes que l’on avait pré-découpées étaient les scènes de neige pour simplifier le transport du matériel en scooter des neiges. Mais à cause du manque de neige, on a dû partir en Italie, puis en Autriche, et tout ce que l’on avait préparé et découpé en fonction des pistes françaises ne marchait plus !
Ces scènes de neige sont à la fois réalistes et poétiques.
Le ski de fond est un sport très lent mais je voulais qu’on sente la compétition, que Samir doit relever un défi, mener un combat pour se qualifier. Là encore, on a fait un gros travail au son pour rajouter des bruits de ski et de respiration. Le ski de fond est un sport très exigeant physiquement. On a tourné avec des vrais champions autrichiens et on était tous épatés de les voir presque s’envoler au-dessus de la neige.
Je voulais donc instaurer du rythme et de l’enjeu dans ces scènes de ski mais tout en préservant le silence et la poésie de la nature. Samir retrouve une seconde jeunesse la première fois qu’il est perdu au milieu des montagnes. Il pousse un cri, traverse l’immensité du paysage, puis disparaît à l’horizon… On éprouve soudain un sentiment de petitesse et d’humilité.
Et le choix d’Isabelle Dumas à la lumière?
Quand elle a lu mon projet, elle m’a dit que ce n’est pas parce que les situations, les personnages et les dialogues étaient réalistes que le film devait être naturaliste et gris ! Je l’ai vraiment laissée travailler en ce sens car moi aussi, j’avais envie de couleurs et de contrastes. Isabelle est très exigeante ; je lui faisais totalement confiance, ce qui me permettait de lui déléguer beaucoup de choses et du coup de me consacrer davantage aux comédiens.
Isabelle s’est retrouvée à porter une caméra de quinze kilos tout le tournage, y compris dans la neige, mais à aucun moment elle n’a renoncé à mon désir d’image en me proposant une caméra plus légère. Elle a fait preuve d’un tel engagement dans le film… De manière plus générale, c’est beau de voir à quel point mon équipe s’est battue pour que le film existe. Elle était soudée très fortement autour des difficultés et de l’envie de mettre en scène cette histoire dont elle savait que c’était celle de mon frère, avec mes parents qui passaient sur le tournage…
Une histoire dont elle avait sans doute le sentiment qu’il était utile de la raconter. D’autant plus aujourd’hui…
Propos recueillis par Claire Vassé