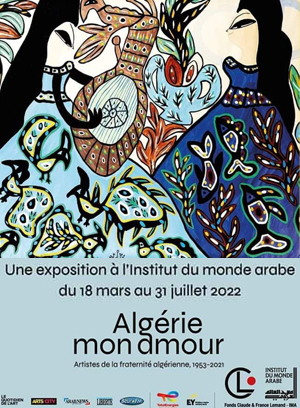Ses parents luttèrent pour l’indépendance de l’Algérie avant d’émigrer en France. Depuis lors, récit intime et grande Histoire traversent le travail de l’artiste.
A l’été 2019, à la question « à quand un artiste franco-algérien à la Biennale de Venise ? », l’artiste Mohamed Bourouissa nous avait répondu : « Je n’y crois pas, les gens ne sont pas encore prêts. » D’après nos informations pourtant, l’artiste franco-algérienne Zineb Sedira, 57 ans, sera la locataire du pavillon français à la Biennale de Venise 2021. Par ce choix, qui devrait être officialisé sous peu par les ministères de la culture et des affaires étrangères, la France adresse au monde un double symbole. Première rupture, avec le machisme : les artistes au féminin se comptent sur les doigts d’une seule main depuis… 1893. Seconde audace, l’affirmation d’une République diverse et ouverte au monde : née à Paris en 1963, Zineb Sédira a le don de jeter des ponts au-dessus des mers, pour rapprocher des cultures intimement brouillées. France et Algérie, bien sûr. Mais aussi Grande-Bretagne, où elle a élu domicile par amour, et Europe.
L’Algérie, pays d’origine de ses parents, qui luttèrent pour son indépendance avant d’émigrer en France pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants, est partout dans son travail. Cette terre lui a inspiré pas moins d’une quinzaine d’œuvres et d’installations, dont certaines ont été présentées à l’automne 2019 au Jeu de paume, à Paris. C’est aussi à Alger qu’elle a créé, en 2011, une résidence d’artistes pour combler le manque de connexions et de visibilité des créateurs locaux.
Zineb Sedira a grandi en France dans les années 1960, quand les blessures de la guerre étaient encore plus vives qu’aujourd’hui. A Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, sa famille cherche à s’intégrer, coûte que coûte, sans broncher devant le racisme et les mots déplacés. Zineb, toutefois, se fait déjà fort de cultiver sa différence. Cheveux courts, look de garçon manqué, elle parle arabe mais fréquente les Français et refuse d’être « une Beurette ». Le bac en poche, elle fabrique des bijoux, s’immerge dans la bohème intellectuelle, s’initie au blues et au jazz avant de migrer à Londres en 1986. Manière de prendre du recul avec la complexe relation franco-algérienne et d’embrasser des questionnements post-coloniaux qui, à l’époque, n’avaient pas leur place en France.
Langues maternelles
A Londres, ses professeurs à la Chelsea School of Art, à Central Saint Martins puis à Slade la poussent à creuser le sujet identitaire et l’autobiographie. La question de la filiation, ce qu’on garde de ses parents et ce qu’on abandonne au cours de la vie, le récit intime mêlé à la grande Histoire traversent depuis lors son travail. En 2002, Mother Tongue, une installation composée de trois petits films, met en scène deux conversations : avec sa propre mère, puis avec sa fille, qui chacune s’exprime dans sa langue maternelle. Si Zineb et sa mère se comprennent et qu’elle-même communique avec sa fille, l’échange est impossible pour les générations divisées par l’immigration : la petite-fille parle anglais quand sa grand-mère ne s’exprime qu’en dialecte algérien.
En 2003, dans Mother, Father and I, ses parents racontent face à la caméra leurs souvenirs d’Algérie et le racisme qu’ils ont connu à leur arrivée en France. Retelling histories : My Mother told me, fruit d’une conversation entre l’artiste et sa mère relatant ses souvenirs, notamment le comportement des soldats français et des harkis pendant la guerre, fait polémique en 2010, au musée Picasso de Vallauris. Deux associations de harkis montent au créneau : l’exposition est fermée pendant deux mois sur décision du maire.
Zineb Sedira pourtant ne cherche jamais à imposer sa vision de l’Histoire, mais se dit passeuse de mémoires et gardienne d’images. Gardienne d’images, c’est d’ailleurs le titre de la vidéo dans laquelle elle recueille la mémoire de Safia Kouaci, veuve du photographe Mohamed Kouaci qui a documenté la guerre d’Algérie. Archiviste dans l’âme, Zineb Sedira s’est mise à collecter à partir de 2014 plaisanteries orales et caricatures de presse de la « décennie noire », qu’elle a exposées en 2018 à la galerie Kamel Mennour qui la représente depuis vingt ans, puis au Jeu de paume en 2019. Aujourd’hui, ce sont les trésors enfouis de la cinémathèque d’Alger qui l’obsèdent.